A. Abelhauser : La folie évaluation. Les nouvelles fabriques de la servitude
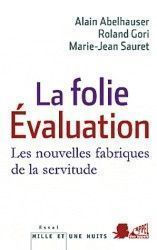
Bernard GENSANE



Cet ouvrage tombe à point. Cela fait environ un demi-siècle que l’entreprise capitaliste étatsunienne utilise l’évaluation pour calibrer, soumettre, surmotiver les travailleurs. Les concepteurs d’outre-Atlantique étaient loin d’imaginer, à l’époque, que la Fonction publique française, l’université en tête (c’est de ce domaine que traite surtout le livre), s’emparerait de cet outil pour l’infliger sans discernement à des populations entières. La droite dure au pouvoir en France depuis 2002 ne s’est pas gênée pour imposer et généraliser la pratique de cet outil.
Avec la finesse et le vocabulaire du Café du Commerce qu’on lui connaît, en proférant une contre-vérité tous les trois mots, le kleiner Mannavait posé le problème de l’évaluation le 4 février 2009 dans un discours où il s’agitait comme un pantin et où il faisait clairement entendre qu’il lisait un texte qu’il avait inspiré mais dont il n’avait pas écrit un mot (http://www.youtube.com/watch?v=iyBXfmrVhrk) : « Franchement, la recherche sans évaluation, ça pose un problème. C’est un système assez génial, d’ailleurs : « celui qui agit est en même temps celui qui s’évalue. Qui peut penser que c’est raisonnable ? Je vois que ça peut être confortable. Je peux en tirer quelques conclusions pour moi-même. » Malgré son parcours universitaire modeste, le kleiner Mann savait fort bien que, depuis toujours, les chercheurs et les laboratoires sont évalués par leurs pairs, dans tous les domaines. On pourra regretter, avec le recul, qu’aucun des présents insultés par le chef de l’État n’ait quitté la salle lors de cette médiocre philippique. Un tel acte de résistance aurait aidé de nombreux universitaires à comprendre à quel point Sarkozy les emmenait dans une démarche de "folie".
Le principal danger de l’évaluation est qu’elle prétend protéger les usagers puisqu’elle est censée rendre des comptes à la société. Dans les faits, elle détourne les évalués de leur mission et elle a un coût énorme pour la société. Sa logique est terrible : « Elle opère comme une gigantesque machine à détourner tout un chacun de sa fonction, à dissuader tout un chacun d’exercer son métier. Il pousse l’évalué à n’avoir d’action que susceptible d’être évaluée à l’aune prévue, il exige de lui qu’il fasse du chiffre et que cela, il détourne les chercheurs de leurs recherches, les soignants de leurs soins, les enseignants de leur enseignement. L’évaluation vide le cœur des métiers de sa substance même. » Comme le disent fort bien les auteurs, « le culte du chiffre, c’est la mort de l’humain ».
L’évaluation, c’est le triomphe de l’économie de marché dans des domaines autrefois préservés. Un peu comme les tristement nocives agences de notation conçues à l’origine pour noter et donner des informations sur les entreprises privées, pas sur les États.
Le premier effet de l’évaluation est une perte de productivité qui atteint parfois plus de 20% : des centaines de milliers d’euros dans un petit hôpital français, par exemple, un tiers des dépenses de santé aux États-Unis. Les évalués s’épuisent à entrer en compétition avec les autres et avec eux-mêmes. L’évaluation porte ainsi atteinte au lien social en constituant comme rivaux potentiels ceux qui devraient s’éprouver comme solidaires. L’évalué est un être d’avance soumis. Les auteurs citent Jacques-Alain Miller : « Consentir à être évalué est beaucoup plus important que l’opération d’évaluation elle-même. » En bout de ligne, l’évalué est formaté par et soumis à l’économie de marché. L’évaluation favorise l’oppression sociale et symbolique, non seulement dans le champ professionnel, mais plus encore dans tous les secteurs de la vie sociale et subjective. Ce qui contribue toujours plus à écraser la pensée et la subjectivité du travailleur, donc le travailleur en tant que sujet libre. Le monde devient mathématisé, toujours plus numérisé, ce qui permet au néo-libéralisme de devenir, selon Bourdieu, « la forme suprême de la sociodicée conservatrice. » Selon les auteurs, l’évalué se soumet à la norme plus qu’à la loi. Le prix d’un travailleur n’a alors de sens qu’en fonction du prix des autres travailleurs. Dans la recherche universitaire, la qualité d’un article n’existe pas en soi, mais par rapport à la qualité de la revue où il est publié, cette qualité étant déterminé par les flics universitaires et les loi du marché (pourquoi n’existe-t-il pas en France de périodique de la qualité du Lancet britannique ?). Comme un fait exprès, les évaluateurs sont rarement les meilleurs d’entre les universitaires. Les bons chercheurs font de la recherche et se désintéressent de ce travail de flicage. D’ailleurs, le flic sera bientôt totalement remplacé par la machine grâce au facteur d’impact, l’ignoble impact factor. Ceux des universitaires qui croient encore dans l’objectivité de l’impact factor sont ceux qui ont vu la vierge. Pour donner un cas exemplaire : la théorie grotesque de la mémoire de l’eau est, selon la logique de l’évaluation, une immense avancée scientifique car elle a fait réagir la communauté scientifique dans son entier. En revanche,L’interprétation des rêves de Freud, thèse hautement novatrice en son temps, est un travail nul pour notre kleiner Mann et ses porte-coton ; elle fut vendue à 228 exemplaires au cours des deux premières années suivant sa parution et il fallut dix ans pour que la première édition de 600 exemplaires fût épuisée. Les chercheurs novateurs, et même les savants Cosinus devront s’y faire : on ne publie plus pour être lu mais pour citer (les copains) et être cité (par les copains).
Au final, l’évaluation permet aux nouveaux mandarins (en gros ceux qui étaient étudiants dans les années 70/80 et qui ont eu un haut-le-cœur rétrospectif post soixante-huitard) d’asseoir un pouvoir arbitraire au nom de ce qu’ils présentent comme de la raison scientifique. L’(auto)flicage des évalués assure un meilleur contrôle de la classe dirigeante sur les travailleurs intellectuels en les déstabilisant en permanence puisque les critères de l’évaluation d’aujourd’hui ne sont pas ceux d’hier et ne seront pas ceux de demain.
(avec R. Gori, M.-J. Sauret). Paris : Mille et une nuits, 2011.
À lire également : une analyse du Parti de gauche sur le projet de réforme de la notation des enseignants :http://www.lepartidegauche.fr/editos/arguments/4333-reforme-...
